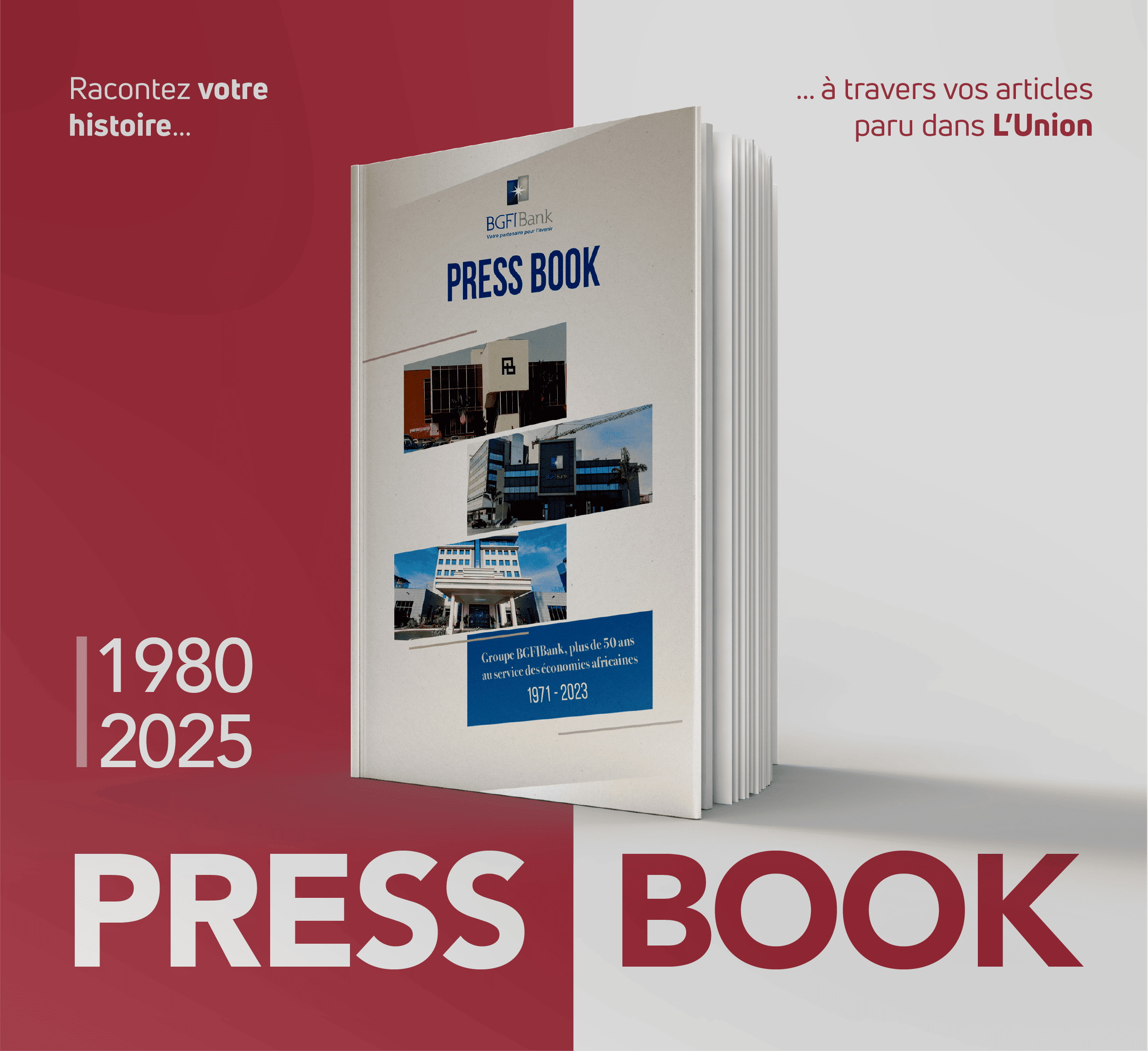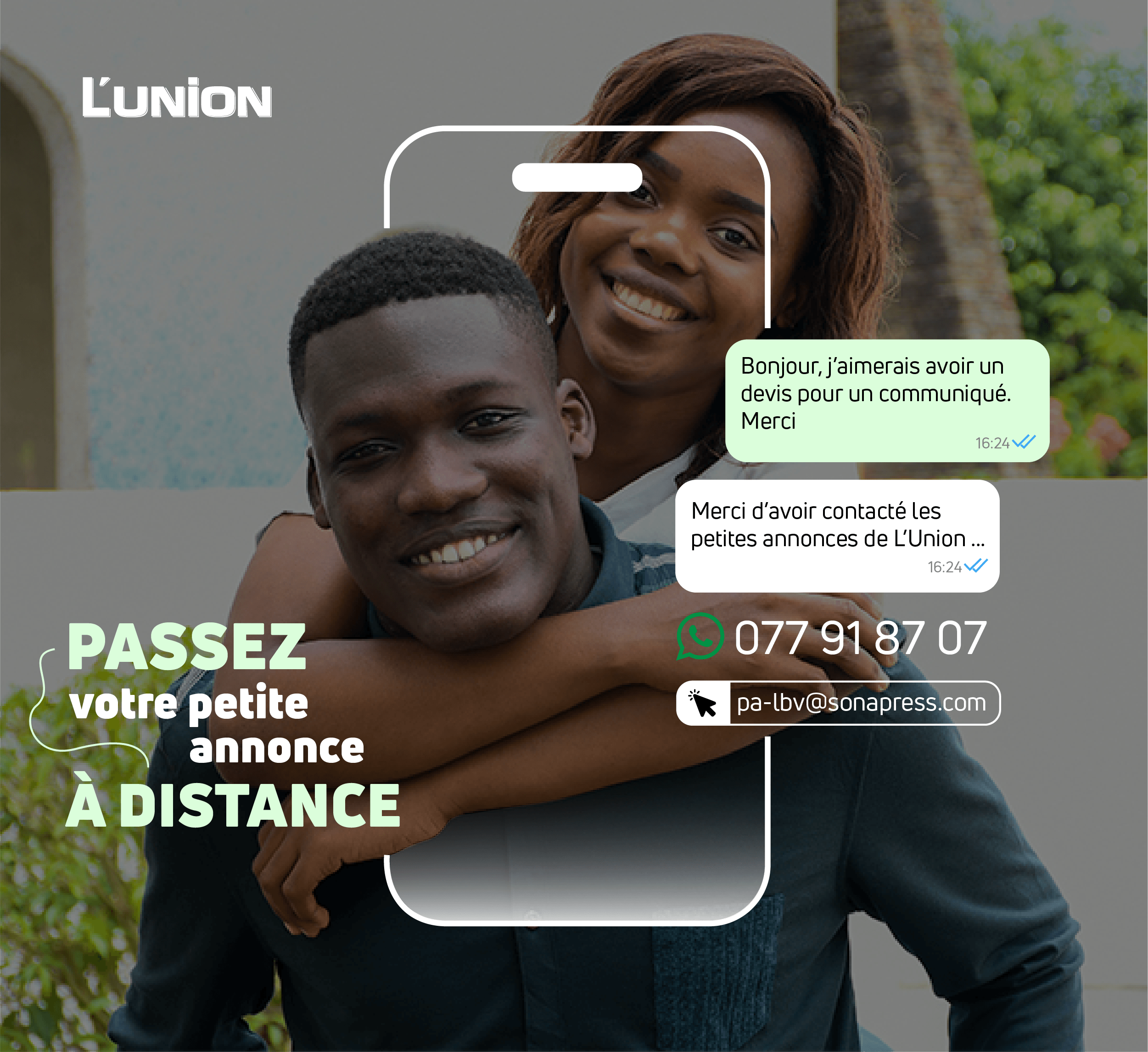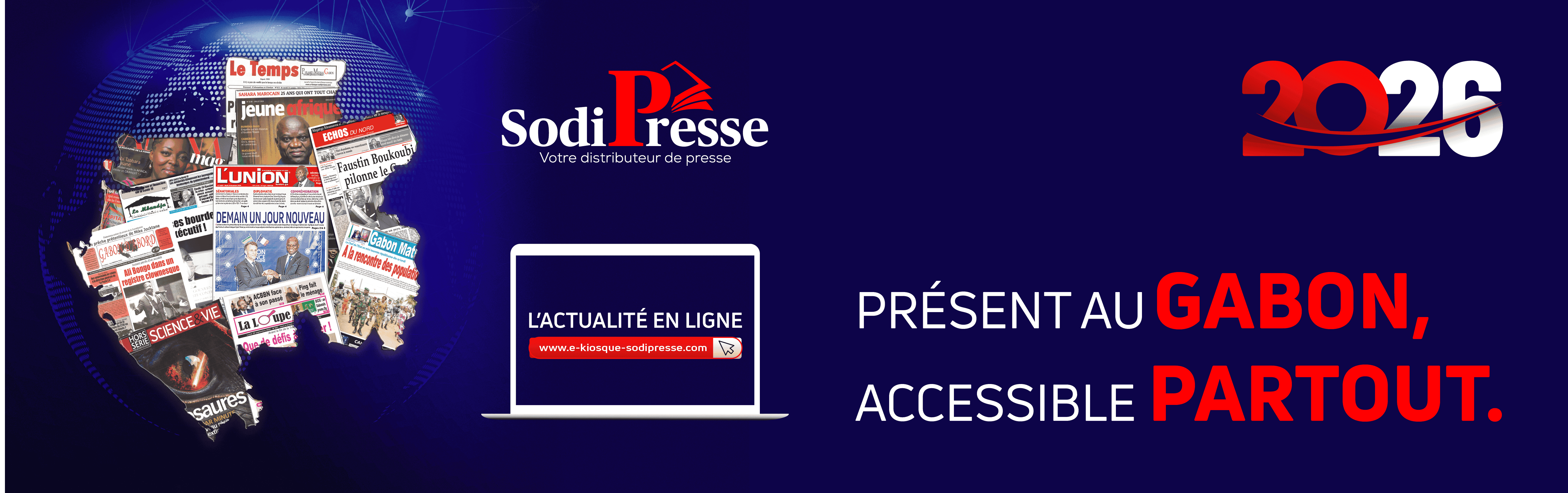Le Conseil des ministres du 12 août dernier a interdit sept métiers aux étrangers (commerce de proximité, envoi d’argent non agréé, réparation de téléphones et petits appareils, coiffure et soins esthétiques de rue, orpaillage artisanal non autorisé, intermédiation informelle dans l’achat de récoltes, exploitation de petits ateliers ou machines de jeux sans enregistrement), avec l’objectif de réduire le chômage, formaliser ces métiers et redonner du pouvoir économique aux Gabonais. Les activités visées sont placées, de facto, dans l'économie informelle.
Il faut comprendre que les personnes qui y travaillent, les "entreprises" qui sont créées dans ces secteurs, n'entrent pas dans la base d'imposition et sont généralement de petite taille, avec une faible productivité et un accès limité aux financements. Une situation qui les empêche généralement de grandir. Pourtant, l’informel représenterait entre 35 et 41% du produit intérieur brut gabonais et empêcherait l'État d'engranger plus de 400 milliards de budget supplémentaire chaque année.
Le Recensement général des entreprises (RGE), publié en 2023 par la direction générale de la Statistique (DGS), révèle l’importance du secteur informel dans l’économie gabonaise. Ainsi, 62,9 % des entreprises exercent dans l’informel, confirmant leur place dominante dans le tissu productif national. L'autre donnée, qui attire l'attention, est qu'environ 20 % des entreprises informelles sont détenues par des Gabonais contre près de 80 % par les étrangers. Une réalité criante lorsqu'on se penche sur le cas du marché Mont-Bouët.
Mais cette situation découle d'une sorte de laisser-aller. Pendant des années, l’État n’a pas voulu créer un écosystème permettant aux Gabonais de capter eux-mêmes cette valeur (on parle de 400 milliards générés par le secteur informel chaque année), parce que le modèle économique gabonais reposait sur la rente pétrolière et minière, marginalisant l’innovation et le secteur informel qui ont été perçus comme "secondaires". De plus, les ressources captées par l’élite (via des contrats pétroliers) étaient peu réinvesties dans la productivité des jeunes, occasionnant un déséquilibre structurel et l'exclusion économique de ces derniers.
L’interdiction devient un signal politique fort : l’État réaffirme sa souveraineté sur le territoire économique. Il faut maintenant que les mécanismes, pour inverser la tendance, soient correctement mis en place et que les nationaux se les approprient.
random pub